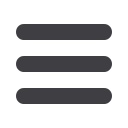

www.
edises
.it
constructivisme socioculturel qui plonge ses racines dans les théories
de Vygotskij. Lors du processus de connaissance, l’esprit recompose
les informations de manière active, il ne fait pas que simplement les
assimiler ou les accumuler puis simplement reproduire. Au contraire
de Piaget, pour qui le développement de l’enfant précède l’appren-
tissage, Vygotskij pense que l’apprentissage social précède le dévelop-
pement : chaque fonction dans le développement culturel de l’enfant
survient tout d’abord au niveau social (« interpsychologique »), puis
au niveau individuel (« intrapsychologique »), dans un processus per-
manent de médiation. Pour Vygotskij, ce n’est pas ce que l’enfant sait
qui est important, c’est ce que l’enfant peut apprendre : l’appren-
tissage devient ainsi une expérience réciproque entre camarades
et adultes, un processus actif et constructif permanent. Conscience
et cognition sont le résultat de la socialisation et du comportement
social. Dans sa théorie de la « zone de développement proximale »,
Vygotskij a souligné comment l’apprentissage de l’enfant se déve-
loppe avec l’aide des autres : un rapport d’entraide qui s’établit donc
entre un sujet plus compétent (adulte ou camarade) et un autre sujet
moins compétent, pour atteindre un niveau plus élevé d’intelligence.
La « zone de développement proximale » représente alors la distance
entre le développement actuel et le développement potentiel cumu-
lable avec l’aide des autres. À la différence de Piaget, pour qui l’en-
fant passe par différents stades dans le processus de développement
puis devient « prêt » à apprendre de nouvelles connaissances qu’il ne
possédait pas auparavant, pour Vygotskij l’enfant apprend de ceux
qui ont un niveau de connaissance supérieur. Nous imaginons quelles
incidences et répercussions a pu avoir cette théorie dans le domaine
de l’apprentissage et de l’enseignement, ouvrant des contextes où les
étudiants jouent un rôle actif dans l’apprentissage, au-delà et contre
toute théorie qui voit l’enseignant comme le seul dépositaire d’un
savoir à simplement transmettre.
Le constructivisme d’abord et le socioconstructivisme ensuite ont
permis de réévaluer la spéci cité des capacités supérieures et le rôle
pris par le contexte : le développement de la pensée supérieure est
in uencé par le contexte social ; la réalité, du reste, n’est pas conce-
vable en fonction d’une structure xe et immuable, mais en fonc-
tion d’une incessante interaction entre individu et environnement,
qui se construisent et se déterminent réciproquement. Les rôles de
l’enseignant et de l’étudiant changent donc : un enseignant peut
collaborer
avec ses étudiants de manière à faciliter la construction de
















