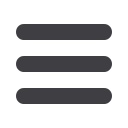
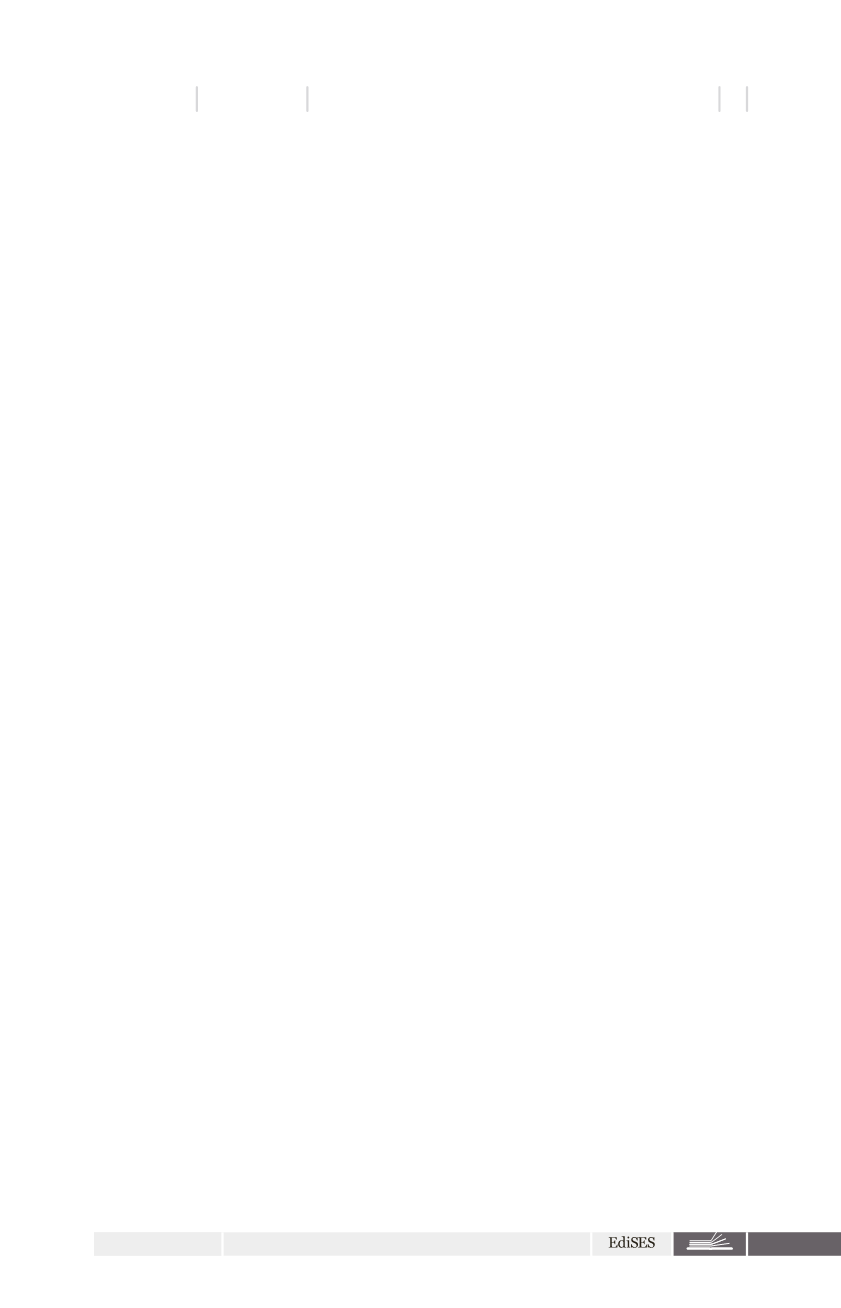
www.
edises
.it
Les auteurs de référence de l’approche comportementaliste sont J.B.
Watson, I. Pavlov, E. Thorndike, B. Skinner.
L’approche cognitiviste prend ses distances avec les modèles com-
portementalistes, déplaçant l’attention du concept d’association
à celui de sujet actif dans l’élaboration de la réalité environnante,
donnant par conséquent une plus grande importance aux proces-
sus internes d’élaboration et représentation. Si pour la perspective
comportementaliste l’apprentissage est étudié à travers le compor-
tement manifeste et traité comme un phénomène « unitaire », pour
la nouvelle perspective cognitiviste, on observe une fragmentation
dans le cadre de la recherche et l’apprentissage est redé ni par rap-
port aux différentes composantes cognitives impliquées. Il constate
notamment une forte association entre l’étude de l’apprentissage et
celle de la mémoire, dans la mesure où, pour pouvoir apprendre, il
est avant tout nécessaire de savoir coder, emmagasiner, intégrer et se
souvenir d’un ensemble d’informations. Par conséquent, du moment
que les informations sont traitées d’abord par les sens puis par la
mémoire, la conception des contenus formatifs doit tenir compte de
la nécessité de garantir ce transfert de la manière la plus ef cace pos-
sible. En effet, lorsque ce transfert ne survient pas immédiatement,
l’information est perdue. La quantité d’informations qui peut être
emmagasinée dans la mémoire relève de deux facteurs :
>
l’attention consacrée aux informations de la part de l’apprenant ;
>
la présence, chez l’apprenant, de structures cognitive adaptées à
les recueillir.
Les auteurs de référence de l’approche cognitiviste sont C. Hull, E.
Tolman, W. Kohler, K.J.W. Craick, G.A. Miller, E. Galanter, K. Pri-
bram, U. Neisser.
Les
constructivistes
estiment que lors du processus d’apprentissage
l’apprenant assume le rôle central tandis que le concepteur/ensei-
gnant assume au contraire un rôle marginal, visant à faciliter le bon
accomplissement de ce processus. Sur la base de cette approche, l’en-
seignant devra produire un parcours didactique tourné sur l’appre-
nant, où celui-ci est actif dans le processus de connaissance : il en dé-
coule que l’intégration d’importantes activités pratiques, simulations
structurées et déstructurées qui stimulent la créativité et la forma-
tion d’un savoir propre sur l’argument objet du cours, est essentielle.
L’apprenant acquerra également les informations en les partageants
avec ses collègues impliqués dans le parcours formatif, servant de
















