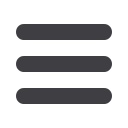

www.
edises
.it
levier aux observations et aux savoirs de ses propres camarades de
cours ; il pourra contribuer ainsi à la formation (à la construction)
d’un savoir collectif.
Les auteurs de référence de l’approche constructiviste sont L.S. Vy-
gotskij, J. Piaget, J. Bruner, D. Merrill.
1.2
L’interaction sociale dans le processus
d’apprentissage
La dynamique qui sous-tend les processus d’apprentissage fournit à
l’interaction sociale un rôle fondamental dans le processus du déve-
loppement cognitif.
Nous avons évoqué combien le concept d’apprentissage a évolué au
cours des vingt dernières années, suivant l’école de pensée cogniti-
viste et constructiviste.
Dans l’optique cognitiviste, toutes les élaborations et réélaborations
que le sujet accomplit sur les informations obtenues acquièrent de
l’importance dans le processus d’apprentissage. Le constructivisme
peut être considéré comme un volet particulier du cognitivisme : Jean
Piaget, par ses études sur les stades du développement cognitif et sur
l’importance des con its cognitifs pour la construction-restructura-
tion de la connaissance, peut être considéré comme le précurseur
du constructivisme. Cependant, le constructivisme ne s’est pas arrêté
aux théories de Piaget et est allé au-delà grâce aux contributions de
chercheurs comme Jérôme Brunner, L.S. Vygotskij, Seymour Papert,
David Jonassen.
Papert, élève de Piaget, s’est penché sur les recherches sur l’intelli-
gence arti cielle vers la n des années soixante-dix, concentrant son
attention sur le développement de ce que Piaget avait dé ni comme
« pensée opératoire ». Dans une période de transformations sociales
et culturelles importantes, Papert - grâce à l’apport des nouvelles
technologies américaines de ces années-là - entendait réaliser des
« gymnases de pensée », des environnements scolaires accueillant la
collaboration et le soutien de l’enseignant et des paires. Cette nou-
velle perspective, dé nie par le chercheur « constructionniste », sous-
entend le partage, la négociation, la médiation de la part de l’ensei-
gnant dans un climat d’échanges et de motivation. Cette théorie vient
abonder la perspective psychopédagogique du « constructivisme so-
cioculturel », qui représente aujourd’hui la principale voie théorique
















