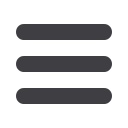

www.
edises
.it
de l’école moderne. Le constructivisme socioculturel envisage la
connaissance comme une construction partagée mais subjective dans
son interprétation, qui nécessite une pensée narrative, ré échie et
métacognitive, au contraire de la précédente tendance « comporte-
mentaliste », fondée sur le mécanisme de transvasement des connais-
sances, en fonction d’une structure de stimulus-réponse. Pour le
constructivisme, la connaissance est complexe, relative, contextuali-
sée et subjective, construite sur un échange incessant de négociation
et partage des signi cations. La connaissance est construite par le
sujet au fur et à mesure que celui-ci tente d’ordonner ses propres
expériences, elle se construit dans l’esprit de celui qui apprend. L’ap-
prentissage devient ainsi « signi catif », actif et collaboratif.
Naturellement, l’environnement d’apprentissage acquiert lui aussi
une nouvelle valeur : il devient laboratoire, lieu où l’on apprend à
interagir avec les autres, en favorisant des processus cognitifs de réso-
lution des problèmes et de recherche de nouveaux points critiques à
dépasser dans un climat de créativité, discussion et échange de points
de vue.
Jean Piaget, lorsqu’il introduit le concept de la structure psycholo-
gique en tant que produit d’un lent processus de construction - qui
survient dans la période de l’enfance - entrevoit la nécessité consé-
quente d’une autorégulation de ce processus, suite à un besoin de
gérer des matériaux et des expériences qui, au fur et à mesure que
l’enfant grandit, deviennent de plus en plus complexes. Le dévelop-
pement est un processus graduel, tendant toujours plus à l’objecti-
vité, la rationalité et la capacité à reconnaître et accepter le point de
vue d’autrui, donnant ainsi naissance à la « socialisation ». De cette
manière, on passe de la « perception » du petit enfant à la « pensée
logique et rationnelle » de l’adolescent et de l’adulte, sachant qu’il
existe, selon le psychologue suisse, une différence qualitative entre
la modalité de pensée de l’enfant et celle de l’adulte. Le concept de
« capacité cognitive » est lié à la capacité d’adaptation dans l’environ-
nement physique et social : dans le cas de l’enfant, il se caractérise
par « l’assimilation » et par « l’accommodation ». Adoptant la thèse
selon laquelle l’interaction sociale est un élément fondateur dans le
processus du développement cognitif, le concept d’apprentissage re-
vêt une nouvelle et indispensable signi cation : l’apprentissage, loin
d’être une activité solitaire, présuppose des processus d’échange,
négociation et coopération. Il s’agit donc, essentiellement, d’un
fait social ; c’est un des présupposés en matière d’apprentissage, du
















