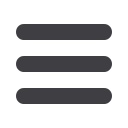

www.
edises
.it
en utilisant des connaissances et des capacités pour approcher des
connaissances toujours nouvelles sera également capable de connec-
ter de nouveaux stimuli et matériels à des connaissances déjà exis-
tantes, et pourra par conséquent le faire après sa vie proprement
étudiante.
Ceci posé, un changement de perspective innovant est demandé à
l’école du XXI
e
siècle, surtout par ceux « qui font » l’école : les ensei-
gnants. Pour être éducateurs, disait Platon, «
il faut aimer ce qui est
enseigné comme les personnes à qui on l’enseigne »
: le travail d’éduca-
tion demandé à l’enseignant d’aujourd’hui est celui de former des
étudiants en mesure d’apprendre pour agir, de les rendre souples
et bien disposés à l’introjection de nouvelles et stimulantes sources
et informations, les prédisposer à se poser des questions, avoir un
regard critique et résoudre les problèmes. L’école, aujourd’hui, a
profondément changé, à l’égal de la société où nous vivons : elle est
multiculturelle et souvent, multilingue. Et pas uniquement. Le dé-
veloppement permanent et que rien ne semble pouvoir arrêter des
technologies de l’information ainsi que leur accessibilité et leur jouis-
sance toujours plus simples aide l’éducation à former des citoyens
en mesure de vivre et agir dans un monde globalisé, qui modi e en
permanence nos façons de penser et de connaître.
Aujourd’hui, l’opportunité d’accès à la culture et à l’apprentissage
est garantie à tous. La « sphéricité » des savoirs est désormais chose
accessible et fortement souhaitable : désormais la science ou les
sciences ne sont plus réservées à des experts, aux professionnels du
secteur, mais chacun peut se les approprier par le biais des différents
canaux et des contextes sociaux ou de regroupements. Edgar Morin
parle de « démocratie cognitive », pour laquelle il sous-entend néces-
sairement une réforme de la pensée, qui se rapporte bien au domaine
de l’enseignement, nécessitant une « formation des formateurs » et
une « auto-rééducation des éducateurs », éduquant les « éducateurs
à une pensée de la complexité », même là où ils rencontrent des obs-
tacles liés à des structures mentales et institutionnelles préformées.
La « réforme culturelle » souhaitée par Morin entend ouvrir la voie
à une connaissance non plus fragmentée en disciplines singulières,
mais en mesure d’encadrer les savoirs et les informations dans un en-
semble : «
réconcilier les savoirs et jeter les ponts, établir des correspondances
entre disciplines qui jusqu’à présent ne communiquaient pas entre elles ».
En
un mot, la pluridisciplinarité. Le problème de la centralisation de
l’apprentissage a certainement conditionné et conditionne toujours
















