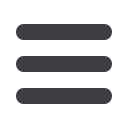

Chapitre deux
La programmation
75
www.
edises
.it
>
le dépassement de la conception traditionnelle d’un curriculum
correspondant aux programmes, qui confondait contenus des dif-
férentes disciplines et inalités éducatives ;
>
le choix, par les enseignants, après une première analyse de la si-
tuation de départ, des parcours qu’ils jugent les plus susceptibles
de respecter les indications générales des programmes ;
>
l’identiication, par les enseignants, des objectifs et leur hiérarchi-
sation ;
>
la sélection des contenus et l’organisation de l’environnement et
des expériences d’apprentissage (temps, espaces, modalités de re-
groupement des élèves, etc.) ;
>
l’évaluation comme partie intégrante de l’action didactique, avec
fonction de régulation de l’ensemble du processus d’apprentis-
sage, divisée en évaluation initiale, formative et sommative, et dis-
tincte du contrôle.
Les objectifs étaient classés en tant que généraux et spéciiques et
leur déinition variait selon les théoriciens. Les tableaux taxono-
miques sont utilisés dans ce modèle, pour réaliser les différentes
unités didactiques, dans lesquelles s’articulent les différents objectifs
spéciiques.
Comme nous l’avons vu précédemment, au début des années 1980
un autre modèle s’est développé en Italie parallèlement à ce modèle
linéaire, grâce notamment aux recherches de Damiano. Ce nouveau
modèle de programmation curriculaire, par carte conceptuelle,
s’inspirait des théories en psychologie de J. Bruner, D. Ausubel et du
structuralisme. Cette didactique axée sur les concepts est apparue
dans les années 1950 aux États-Unis pour réformer les curriculums,
principalement ceux des matières scientiiques. Selon Bruner, baser
les curriculums sur la structure des disciplines pouvait :
>
permettre d’anticiper l’apprentissage des concepts fondamen-
taux : pour chaque connaissance, il est possible de trouver une
version adaptée à l’âge ;
>
donner les outils pour continuer à apprendre, en utilisant les disci-
plines comme des «
méthodes particulières de pensée servant à déterminer
des catégories de phénomènes
» ;
>
faciliter le transfert général au cours de l’apprentissage.
La recherche sur la structure des disciplines a été développée ulté-
rieurement par J.J. Schwab.
















